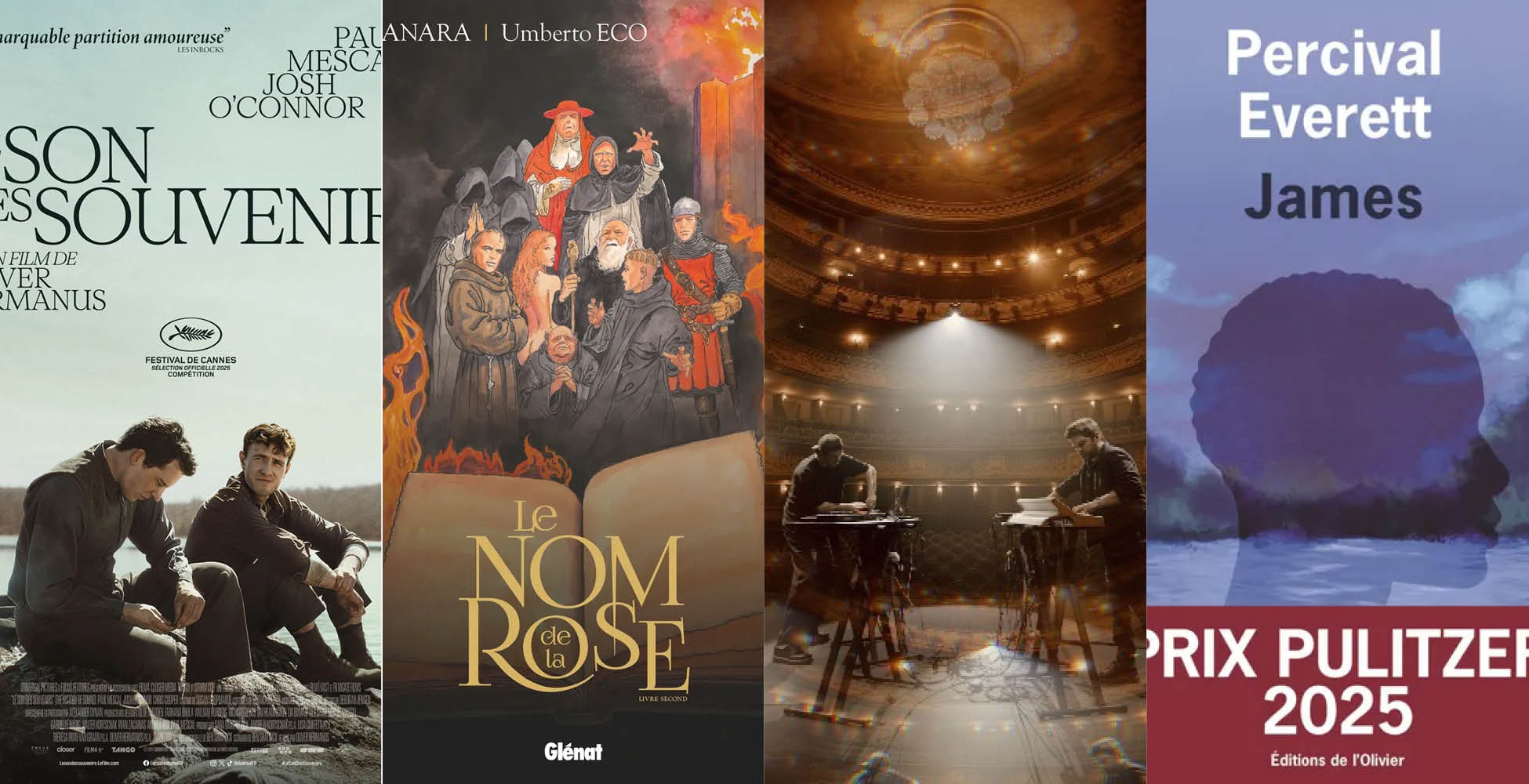Ambroise Michel – Un regard passionné sur le court-métrage.
HORS-SERIE CINEMA EN LIBERTE DU 18 JUILLET AU 20 JUILLET A TOULON
Comédien révélé par la série « Plus belle la vie », Ambroise Michel est aussi réalisateur et scénariste de courts-métrages exigeants et engagés. À l’occasion de la nouvelle édition du Festival Cinéma en Liberté à Toulon, il rejoint le jury avec enthousiasme. Rencontre avec un artiste passionné, défenseur d’un cinéma libre et inventif..
Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le jury du Festival Cinéma en Liberté ?
Je ne connaissais pas ce festival avant que Sam Bobino, parrain de cette édition, ne m’en parle. On échangeait autour de l’un de mes courts-métrages récents, et même si la sélection était déjà faite, il m’a présenté le projet. J’ai regardé ce qu’ils faisaient et j’ai tout de suite été séduit par l’esprit familial, indépendant, très humain. Ce sont ces festivals de proximité, portés par la passion, qui me touchent. Ils tiennent bon malgré le manque de moyens, alors qu’un grand nombre disparaissent chaque année. Soutenir ce genre d’événement, c’est soutenir une certaine idée du cinéma, plus libre et plus sincère.
Le court-métrage semble occuper une place centrale dans votre parcours. Qu’est-ce que ce format représente pour vous ?
C’est, à mes yeux, l’un des derniers espaces de liberté créative totale. Il permet de s’affranchir des contraintes narratives, financières ou commerciales qu’imposent souvent les longs. Le court, c’est l’expérimentation : on peut tenter, rater, recommencer. Mélanger les genres, explorer un univers, tester une idée visuelle ou narrative. C’est un format qui encourage la singularité. Et en tant que réalisateur, c’est aussi une manière d’exister sans attendre le feu vert d’une production lourde. Je pense qu’on peut faire du cinéma exigeant, fort et marquant en moins de quinze minutes.
Quel est votre regard sur la place du court-métrage aujourd’hui ?
Malheureusement, il reste sous-valorisé. Ce sont pourtant des œuvres à part entière, souvent très riches, parfois même plus percutantes qu’un long. Le problème, c’est la diffusion : rares sont les chaînes qui les programment, ou alors à des heures tardives. Avant, ils étaient projetés en salles avant les longs ; aujourd’hui ça a disparu. Les distributeurs préfèrent payer l’amende plutôt que de diffuser un court. C’est dire le manque de reconnaissance. Pire encore : de nombreux festivals ont disparu. Sur ceux où j’avais envoyé un précédent film en 2018, 80 % n’existent plus aujourd’hui. C’est révélateur de la place fragile de la culture dans notre société. Et pourtant, il y a une vraie richesse dans ce format, une énergie, une manière unique de raconter.
Quel conseil donneriez-vous à la nouvelle génération qui veut se lancer dans le court-métrage ?
Commencez par le scénario. Trop souvent, on pense logistique avant de penser récit. Or, l’écriture, ça s’apprend. Il y a des méthodes, une technicité, une dramaturgie à connaître pour pouvoir ensuite s’en affranchir. Ensuite, il faut comprendre que la réalisation est un langage à part entière, avec sa grammaire, son rythme. C’est comme une partition musicale : si les notes sont là mais que le tempo est faux, ça ne fonctionne pas. Et surtout, formez-vous au montage. C’est là que le film prend vie, que l’histoire se précise, que le rythme se crée. Pour moi, un bon monteur est presque un second réalisateur. Mon conseil, au fond, c’est : soyez exigeants, apprenez, expérimentez. Et ne renoncez pas à vos envies, même dans un système qui valorise peu ces formats.
Grégory Rapuc