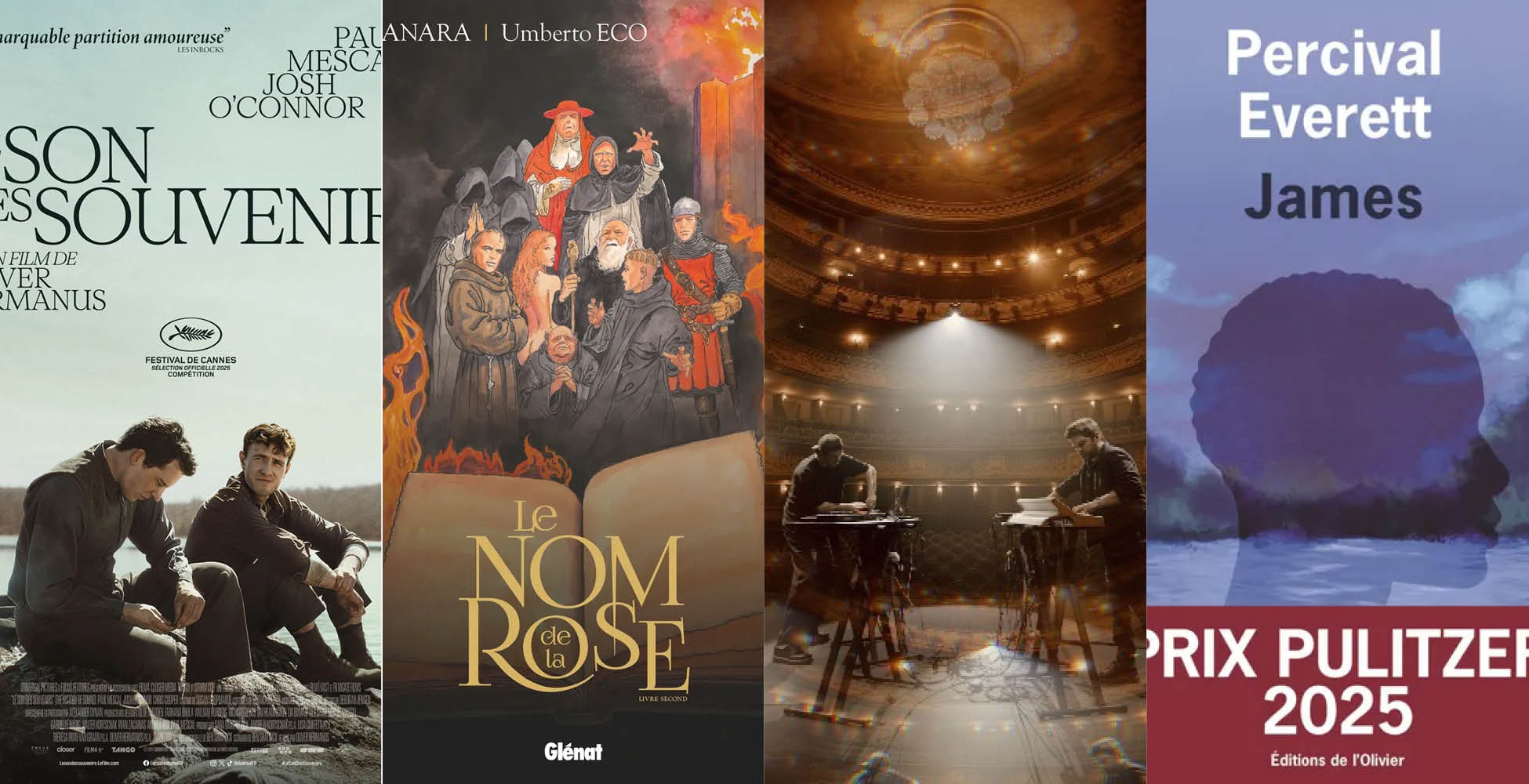Audrey Schebat – Un bon récit touche, quelle que soit sa forme.
HORS-SERIE CINEMA EN LIBERTE DU 18 JUILLET AU 20 JUILLET A TOULON
Audrey Schebat, autrice, scénariste et metteuse en scène, fait partie du jury du festival. Elle nous parle de son engagement, de sa vision du format court et de son regard d’artiste sur ce type de création.
Pourquoi avoir accepté de faire partie du jury de ce festival ?
Le court-métrage est un format fondamental mais souvent sous-estimé. C’est un passage incontournable pour beaucoup de cinéastes. Il n’a pas d’économie propre, et sa diffusion reste marginale. Les festivals sont donc essentiels : ils permettent au public de découvrir ces œuvres et offrent une visibilité aux auteurs. Participer à un jury, c’est une manière concrète de soutenir cette forme, de la défendre, de la mettre en lumière. Cela me semble presque un devoir pour ceux qui aiment ce métier.
En quoi votre expérience au théâtre, au cinéma ou à la télévision influence-t-elle votre regard de jurée ?
Quel que soit le médium, ce qui fait la différence, c’est l’histoire. Une œuvre, courte ou longue, doit émouvoir, toucher, créer un lien avec le spectateur. Le court-métrage oblige à une grande rigueur : transmettre un univers, une émotion, une idée forte en très peu de temps. Cela demande de la précision, mais aussi une vraie vision. Peu importe le support, c’est la sincérité et la force du propos qui comptent.
L’écriture est-elle, selon vous, plus importante que la technique ?
Oui, l’écriture est à la base de tout. On peut avoir peu de moyens, pas de décors ni d’effets, et pourtant bouleverser un public si le texte est juste. À l’inverse, une œuvre techniquement parfaite mais vide de sens ne laissera aucune trace. L’écriture structure, porte le rythme, les émotions. Même au théâtre, une simple lecture d’un bon texte peut suffire à créer de l’intensité. L’écriture est l’âme du projet.
Quel rôle joue encore un festival de courts-métrages aujourd’hui ?
Un rôle capital. Sans lieu de diffusion, le court-métrage disparaît. Il ne reste que les plateformes ou les autoproductions visibles en ligne, mais ce n’est pas suffisant. Le festival crée un cadre, une reconnaissance. Il permet aux jeunes réalisateurs de montrer leur travail, de rencontrer des professionnels, d’espérer des collaborations. C’est aussi un outil d’émergence : beaucoup de grands cinéastes ont commencé par là.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune réalisateur ?
Faites, même avec peu de moyens. Le court-métrage dépend surtout de votre énergie et de votre envie. On peut réunir quelques personnes, un peu de matériel, monter une équipe autour d’une idée forte. C’est un premier pas concret, un espace de liberté. Cela vous permettra aussi de rencontrer d’autres talents, de fédérer autour de vous. Trouver sa voie passe par l’action, et le court-métrage en est souvent la première étape.
Le format court vous semble-t-il porteur d’une émotion particulière ?
Un court-métrage peut parfois marquer plus durablement qu’un long. Sa brièveté oblige à aller droit au cœur de l’émotion ou du propos. Quand c’est réussi, cela laisse une empreinte immédiate, presque viscérale. C’est aussi un laboratoire de formes, où les réalisateurs peuvent expérimenter des narrations, des rythmes ou des esthétiques qu’ils n’oseraient pas sur un format plus long. Cette liberté est précieuse, et elle mérite d’être valorisée.
Grégory Rapuc