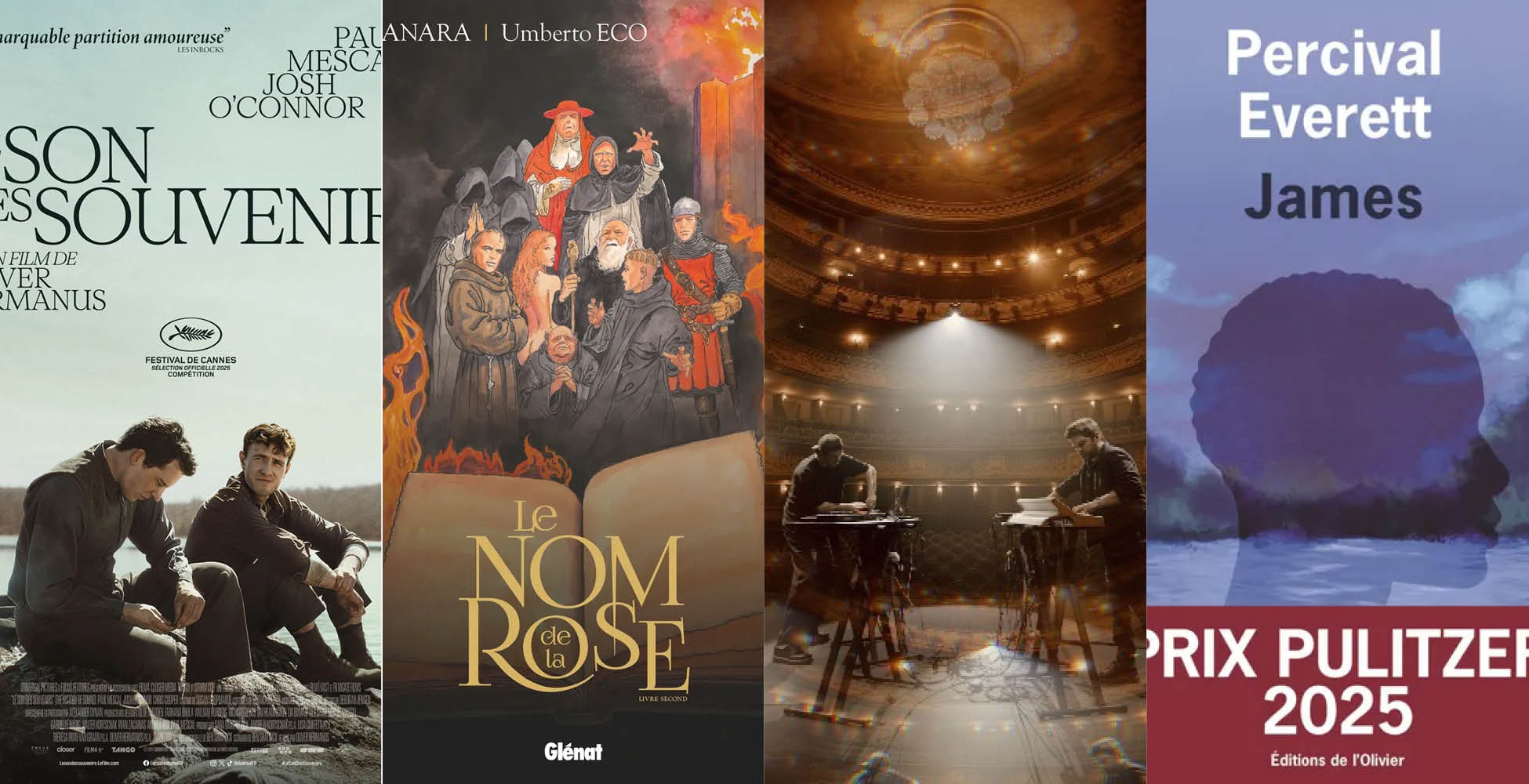Biréli Lagrène – Trouver sa singularité.
En concert à Jazz à Toulon, le 26 juillet sur la Place de la Liberté
À l’occasion du Festival Jazz à Toulon, où il se produira en ouverture entouré de deux autres virtuoses de la guitare, Martin Taylor et Ulf Wakenius, le célèbre guitariste revient sur ses influences, sa vision du jazz et son lien avec le public.
Vous avez exploré une grande variété de styles, du jazz manouche au jazz fusion. Qu’est-ce qui vous inspire aujourd’hui lorsque vous montez sur scène ?
Ce qui m’inspire, c’est avant tout l’instant. Je ne monte jamais sur scène avec une idée figée. En ce moment, j’ai une attirance particulière pour les sons électriques, tout ce qui touche au jazz fusion, au jazz-rock, au bebop aussi. Ce sont des couleurs qui me parlent beaucoup. Mais je n’ai jamais totalement laissé de côté le côté plus acoustique ou plus roots de la musique. J’ai besoin de pouvoir changer d’atmosphère d’un morceau à l’autre, ou même à l’intérieur d’un même morceau. Je ne supporte pas la routine musicale. Le jazz permet cette liberté, ce mouvement perpétuel. C’est ce qui me plaît : ne jamais faire deux fois exactement la même chose, rester dans le vivant, dans la surprise.
Vous avez commencé très jeune dans le sillage de Django Reinhardt. Comment votre rapport à la musique a-t-il évolué au fil des années ?
Quand on débute, surtout très jeune, on passe par la phase d’imitation. J’ai beaucoup, beaucoup joué du Django à mes débuts. Je l’ai imité, copié même, parce que c’était ma référence absolue. Et puis vers seize ou dix-sept ans, j’ai compris que je ne pouvais pas passer toute ma vie à imiter quelqu’un, même un génie. À un moment donné, il faut chercher sa propre voix. C’est une étape essentielle pour tout musicien. On rend davantage hommage à ses maîtres en trouvant sa singularité qu’en les reproduisant à l’identique. J’ai eu la chance de pouvoir m’émanciper, d’oser explorer d’autres territoires musicaux. Django reste un père spirituel, évidemment, mais je ne me suis jamais senti obligé de rester uniquement dans cette esthétique. Pour moi, l’hommage véritable passe aussi par l’évolution.
Le Festival Jazz à Toulon est un événement en plein air, gratuit, qui attire un public très large. Comment abordez-vous ce type de concert ?
C’est un contexte très particulier, et en même temps très stimulant. Sur un festival comme Toulon, on joue devant un public très mixte : des connaisseurs, mais aussi des curieux, des passants. Il faut capter l’attention rapidement, créer une connexion immédiate. Il y a parfois des gens qui s’arrêtent quelques minutes seulement, alors il faut aller à l’essentiel, transmettre une énergie forte. Contrairement à une salle de concert, où le public est venu spécifiquement pour vous écouter, ici il faut “donner plus” dès le début. C’est un exercice qui oblige à une certaine générosité. Et le public du Sud, je le connais bien : il est chaleureux, direct, très réactif. Il y a une vraie proximité. Dans d’autres régions, on sent parfois plus de retenue, il faut aller chercher les gens. Mais dans le Sud, la connexion se fait souvent très vite.
Avec toutes vos expériences, quel rapport entretenez-vous aujourd’hui avec la guitare et la création ?
C’est drôle, mais je crois que je redécouvre mon instrument. Pendant longtemps, j’étais sur les routes en permanence. Je jouais tous les soirs, donc je n’éprouvais pas le besoin de travailler chez moi. Mais depuis quelques années, j’ai retrouvé le goût du travail personnel, du temps passé seul avec l’instrument. Je bosse des gammes, je cherche de nouvelles idées. Ce sont des moments précieux. Et puis j’écoute aussi des choses très variées, parfois du classique, parfois des nouveautés trouvées par hasard sur internet. Mais ce qui m’anime vraiment, c’est ce lien direct avec la guitare. Elle continue de m’apprendre des choses. Et tant que cette curiosité-là est vivante, la musique reste une aventure.
Grégory Rapuc