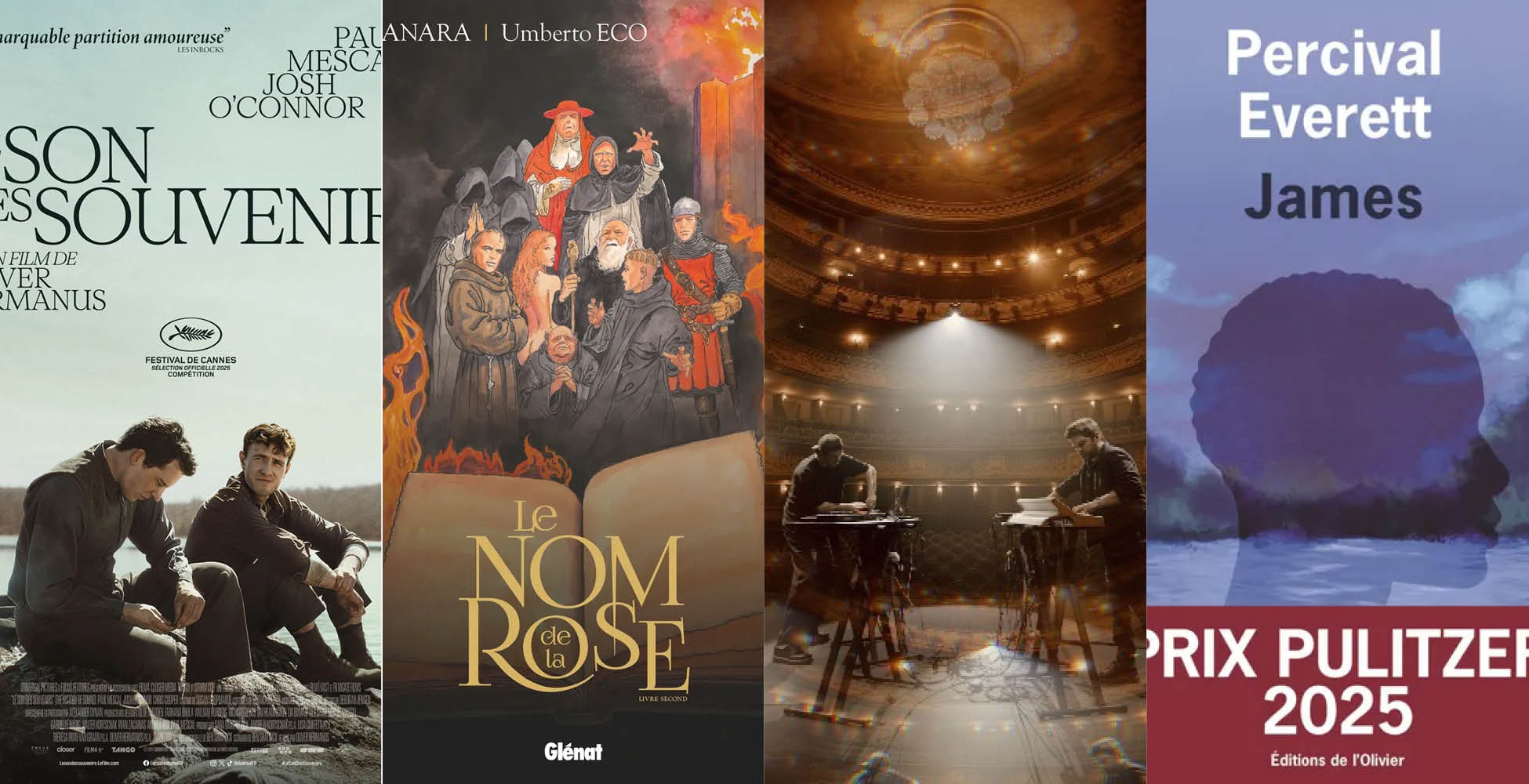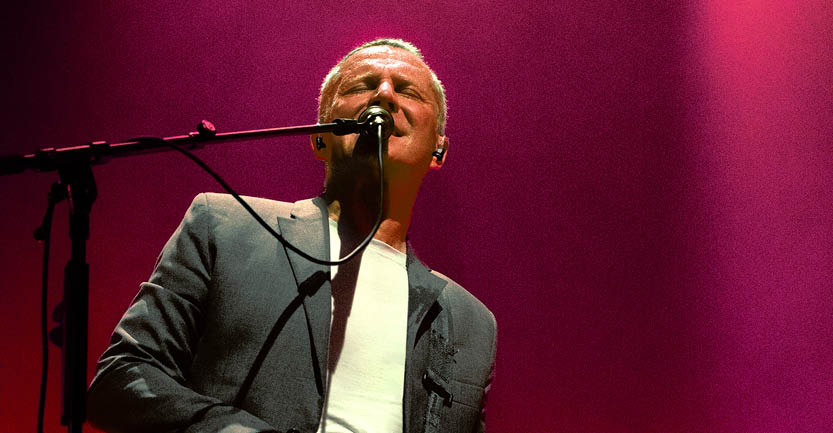Entre pierres et mer #14 – Hommage à la féminité dans les textes sacrés au XVIe s.
Hors-Série – Les Voix Animées
La quatorzième édition du cycle de concerts « Entre pierres et mer » des Voix Animées sera féminine… Tel un retable en trois volets, ce cycle se veut un témoignage de la place occupée par les femmes dans la musique sacrée du XVIe siècle… une évidente source d’inspiration, de piété et une trop rare présence en tant qu’actrices de leur art.
Tour à tour, Susanne, Marie-Madeleine et Marie mère de Jésus vont illuminer de leur intense présence mystique les concerts du cycle « Entre pierres et mer ». La musique sacrée au XVIe siècle est, comme la société de l’époque, très influencée par la pensée humaniste. La foi en Dieu tend à remplacer la crainte de Dieu médiévale ce qui n’est pas sans incidence sur la démarche des compositeurs dans leur quête artistique et spirituelle, elle intègre la pensée et les réalités de leur temps.
Lorsqu’il est question de la place de la femme dans la musique sacrée et de manière plus générale dans la musique au XVIe siècle, il faut préciser les contours de la question ou du moins préciser les contours de la réponse à une telle question. De quoi parlons-nous ? De la femme comme source d’inspiration des compositeurs de l’époque ? Elle s’impose d’une évidente manière dans la musique profane, les chansons galantes, les chansons grivoises et les divers hommages aux femmes puissantes de l’époque, de l’antiquité ou de la mythologie en attestent. Dans le domaine de la musique sacrée, la composante féminine de l’inspiration est également loin d’être négligeable. L’église catholique romaine, en réaction à la réforme protestante encouragea de plus belle le culte des saints et des saintes rythmant ainsi l’année liturgique. « La Légende dorée », ouvrage du dominicain Jacques de Voragine écrit au XIIIe siècle et édité à la fin du XVe siècle connaît un succès considérable et accompagne cet élan vers les saints et martyrs de l’Église. Les saintes y sont célébrées au même titre que les saints et les compositeurs écrivent ainsi de nombreuses œuvres en leur honneur.
Marie, mère de Jésus et depuis le concile d’Éphèse en 431 « Mère de Dieu » est, elle aussi, très célébrée par les compositeurs de la Renaissance. Les fêtes de l’Annonciation, de l’Assomption, de la Visitation, de la Nativité de Marie… sont autant d’événements à célébrer en musique.
Quant à la place des femmes compositrices dans la musique au XVIe siècle, elle reste très limitée voire quasi inexistante… sur les quelques mille deux cents compositeurs connus de la Renaissance, elles sont seulement quatre nées avant 1600, Maddalena Casulana, Vittoria (Raffaella) Aleotti, Leonora d’Este, Francesca Caccini… Des motets de Sœur Raffaella (Aleotti) sont programmés dans le deuxième volet de ce cycle.
La création musicale à l’abbaye du Thoronet
Depuis la création du cycle de concerts à l’abbaye du Thoronet, Les Voix Animées, soucieuses d’intégrer l’acoustique si particulière de l’abbaye à leur projet artistique, ont passé de nombreuses commandes à des compositeurs et compositrices en leur demandant de composer non seulement pour leur effectif a cappella mais aussi pour ce lieu remarquable. Un cahier des charges tout en cohérence avec le répertoire ancien abordé par l’Ensemble. Chacune des œuvres chantées lors de nos concerts ont été créées pour un lieu donné et parfois même pour un événement donné tel le fameux motet « Nuper rosarum flores » de Guillaume Dufay composé pour l’inauguration du Dôme de Florence le 25 mars 1436.
L’abbaye du Thoronet, haut lieu de concerts, mérite bien d’être célébrée à son tour par une création dédiée. Cette année, Tomás Bordalejo est le compositeur associé au cycle « Entre pierres et mer ».
Susanna
Susanne apologie de la vertu.
Le 8 août à la Tour Royale à Toulon, le 9 août à l’abbaye du Thoronet, le 10 août à la Chapelle Saint-Ferréol à Viens.
Source puissante d’inspiration aux résonances contemporaines, l’histoire de Susanne et des deux vieillards, au chapitre treize du livre de Daniel dans l’Ancien Testament, inspira au poète Guillaume Géroult un remarquable poème dont s’emparèrent de nombreux compositeurs au XVIe siècle.
Susanna, un programme aux forts accents « metoo »…
L’histoire de Susanne et les deux vieillards est un des textes apocryphes les plus populaires. Susanne était renommée pour sa piété et sa chasteté. Elle était l’épouse d’un homme riche, propriétaire d’un grand jardin, où siégeait le tribunal. Sa beauté enflamme deux anciens qui viennent d’être élus. Ils s’efforcent de se cacher l’un à l’autre la passion qui les ronge, mais ils finissent par se l’avouer. Une fois que Susanne, afin de combattre la chaleur, s’est dépouillée de ses vêtements pour prendre un bain, les deux vieillards, qui s’étaient cachés, se jettent sur elle et lui demande de satisfaire leur passion. Comme elle s’y refuse, ils poussent des cris et ameutent la foule, ils disent avoir surpris Susanne avec un jeune homme qui s’est enfui… Elle a beau nier en prenant Dieu à témoin et en jurant de sa pureté, elle est menée devant le tribunal qui, sur le témoignage des deux vieillards, la condamne à mort. C’est alors que le jeune Daniel prend sa défense, il s’indigne contre la foule et confond les deux anciens en prouvant leur fourberie. Ce sont finalement les vieillards indignent qui sont chatiés.
Susanne un jour est un poème en langue française de Guillaume Guéroult (1507–1569). Le texte s’inspire de l’histoire de Susanne, dans le livre de Daniel. Le poème est publié en 1548 à Lyon dans le Premier livre de chansons spirituelles, fréquemment réédité au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle.
Susanne un jour d’amour sollicitée
Par deux vieillards convoitant sa beauté
Fut en son cœur triste et déconfortée
Voyant l’effort fait à sa chasteté.
Elle leur dit : si par déloyauté
De ce corps mien vous avez jouissance,
C’est fait de moi ! Si je fais résistance,
Vous me ferez mourir en déshonneur :
Mais j’aime mieux périr en innocence
Que d’offenser par péché le Seigneur.
Didier Lupi Second met ce texte en musique avant 1560 ; cette version connaît un grand succès, et le texte est adapté par de nombreux autres compositeurs jusqu’au milieu du XVIIe siècle. On en connaît une quarantaine de versions, pour voix et pour instruments (notamment pour le luth) par une trentaine de compositeurs différents dont : Orlande de Lassus, Cypriano de Rore, Jean de Castro, Pierre Roussel, Noé Faignient, Gerardus van Turnhout, Didier Leblanc, Jean Servin, Paschal de L’Estocart, Alfonso Ferrabosco, André Pevernage, Eustache du Caurroy, Thomas Champion, Jan Pieterszoon Sweelinck, Claude Le Jeune, Bernhard Jobin, Elias Mertel, Jean-Baptiste Besard, Emanuell Adrienssen, Giovanni Antonio Terzi, Sixtus Kägel, Guillaume Morlaye, Giovanni Bassano, Girolamo Dalla Casa, Francesco Rognoni.
Lassus s’inspire de sa propre chanson spirituelle à 5 voix pour composer sa Missa ad imitationem moduli Susanne un jour. Cette messe parodie savamment composée fait entendre tout au long des diverses parties de la messe, kyrie, gloria, credo, sanctus, benedictus et agnus Dei, les thèmes de la chanson polyphonique en une séduisante proposition.
Pour compléter ce programme, Les Voix Animées vous proposent des chansons spirituelles d’autres compositeurs sur cette même histoire ainsi que des motets sur des textes extraits du « Cantique des cantiques » célébrant la féminité.
Orlande de Lassus né à Mons en 1532 et mort à Munich le 14 juin 1594, maître de chapelle à la cour de Bavière. Il a composé plus de 2000 œuvres sacrées et profanes.
William Byrd né à Londres en 1540 et mort à Stondon Massey le 4 juillet 1623, gentilhomme de la chapelle royale à Londres. Plus de 500 œuvres lui sont attribuées.
Gregor Lange né à Havelberg en 1552 et mort à Breslau le 1er mai 1587, chantre à Sainte-Marie de Francfort-sur-l’Oder. Ses compositions ont été éditées à Francfort chez Andreas Eichorn.
Alfonso Ferrabosco né à Bologne en janvier 1543 et mort à Bologne le 12 août 1588, musicien au service d’Elisabeth Ire , il introduit le madrigal italien en Angleterre.
Jacob Handl né à Ribnica le 3 janvier 1550 et mort à Prague le 18 juillet 1591, chantre de la chapelle royale à Vienne et à Prague. Il est le compositeur de la Contre-Réforme en Bohème.
Cipriano de Rore né à Renaix en 1515 et mort à Parme en septembre 1565, maître de chapelle à la Basilique Saint-Marc de Venise. Il est réputé pour son œuvre madrigalesque.
Giaches de Wert né Bornem en 1535 et mort à Mantoue le 6 mai 1596, maître de la chapelle ducale Sancta Barbara de Mantoue. Sa musique éditée représente plus de 280 œuvres.
Giovanni Pierluigi da Palestrina né à Palestrina le 17 décembre 1525 et mort à Rome le 2 février 1594, maître de chapelle de la Basilique Saint-Pierre au Vatican. On lui attribue plus de 650 œuvres.
Programme
Surge Propera • Orlande de Lassus
Susanna fair • William Byrd
Veni dilecte mi • Gregor Lange
Susanna fayr • Alfonso Ferrabosco
Tota pulchra es • Jacob Handl
Alma Susanna • Cipriano de Rore
Adesto dolori meo • Giaches de Wert
Susanne un jour • Orlande de Lassus
Missa Susanne un jour • Orlande de Lassus
Osculetur me* • Tomás Bordalejo
Susanna ad improbis senibus • Giovanni Pierluigi da Palestrina
Distribution
Faustine Rousselet, soprano
Eva Plouvier, soprano
Maximin Marchand, contre-ténor
Damien Roquetty, ténor
Camille Leblond, ténor
Luc Coadou, basse